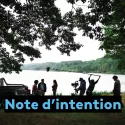Surface
Interview d'Olivier Norek

Le passé qui refait surface, le jeu des apparences, le visible et l’invisible... Est-ce que ce titre, Surface, peut résumer à lui seul la trame du roman ?
O. N. : Surface est ce que j’appelle un « titre-architecture » qui contient en lui-même la totalité du roman. Il évoque tout ce qui se passe en dessous et au-dessus, l’enfoui et l’évident, l’ombre et la lumière. Le visage blessé de Noémie, par exemple, en est le symbole : mutilé en surface, il révèle un verso qu’elle voudrait dissimuler.
Par ailleurs, le titre donne tout son sens à l’enquête, qui réveille un cold case endormi depuis plus de vingt ans. Résoudre l’affaire, c’est (re)plonger sous la surface de ce village englouti et de ses souvenirs devenus secrets. Finalement, en investissant le terrain du concret et du symbolique, Surface permet de structurer l’intrigue.
Vous vous qualifiez d’« auteur de terrain » et de « piètre imaginateur ». Vos récits sont toujours nourris de vos expériences et des univers qui vous entourent. Quelle est la part de réel dans Surface ?
O. N. : Surface, c’est évidemment une enquête haletante et son lot de rebondissements. Mais à l’origine, ce que je voulais vraiment raconter, c’est le poids du regard des autres, auquel j’ai été moi-même soumis à certaines étapes de ma vie. Ce regard qui juge, qui moque, qui empêche. À l’heure des réseaux sociaux particulièrement, nous vivons dans une ère d’exposition constante où il faut se montrer sous sa meilleure facette. J’ai voulu briser cela en détruisant la surface du personnage principal. Surface, c’est aussi ça : se chercher, se trouver et s’aimer tel qu’on est.
Noémie Chastain aurait pu être Noé Chastain. Pourquoi avoir choisi une femme comme personnage central ?
O. N : Aujourd’hui encore, les femmes sont trop souvent renvoyées à leur apparence. Dans le cinéma ou la musique, être belle reste un prérequis. Je voulais dénoncer cette injonction à laquelle ne sont pas soumis les hommes. Chez l’homme, la cicatrice est synonyme de bravoure et de courage, des qualificatifs qui ne sont pas associés au féminin. Narrativement, blesser le visage d’une femme est donc un geste fort.
L’avez-vous rencontrée, Noémie Chastain, dans votre passé d’ancien capitaine de la police judiciaire ?
O. N. : Noémie Chastain est une amie policière, qui existe sous un autre nom. Tombée dans un guet-apens il y a quelques années, elle a été sauvagement agressée en y laissant une partie de son visage sous les coups d’une barre de fer. Je me souviens de sa reconstruction et de sa combativité. J’ai vu cette jeune femme remonter à la surface, gravir les échelons jusqu’à intégrer les services d’élite de la police nationale. Son courage, je le retrouve à travers l’héroïne de mon roman.
Laura Smet a été choisie pour incarner Noémie Chastain. A-t-elle réussi à interpréter la grammaire du personnage et à traduire toute sa complexité ?
O. N. : Laura est une femme assumée, complète, très animale dans son regard et son attitude. Au contraire, mon personnage est brisé, vulnérable et plus discret. Pourtant, Laura s’est complètement caméléonisée au rôle. Dès les premières scènes, elle a su habiter Noémie, une femme qui l’a beaucoup touchée.
Surface a quelque chose de cinématographique dans son écriture. Est-ce un roman pensé pour l’écran, dès sa rédaction ?
O. N. : J’écris avec une caméra sur l’épaule. Tous mes romans sont visuels et peuvent être adaptés, même si ce n’est jamais une intention de départ. Autrement, je n’aurais pas imaginé ce village englouti, ces scènes sous-marines, cette cicatrice, qui sont des éléments gourmands en effets spéciaux et difficiles à traduire en image. Pourtant, Quad Production en a été capable, et le résultat à l’écran en est la preuve.
Déléguer son roman à d’autres et en accepter les réécritures, ce n’est pas trop douloureux ?
O. N. : Pour beaucoup, l’adaptation est une trahison. Je vois les choses autrement. Pour moi, un roman admet autant de versions qu’il a de lecteurs. Nous comprenons les personnages, visages et paysages à la lumière de notre banque d’images personnelle. En tant que lecteurs, nous sommes déjà des réalisateurs. Lorsque je confie mon roman à des scénaristes, j’attends donc leur vision, et non une copie de la mienne.
Vous êtes auteur, mais aussi grand consommateur de polars. Pourquoi ce genre ?
O. N. : Pour moi, le polar est le filtre le plus simple et le plus puissant pour parler d’une époque. La mort et la violence sont des réalités qui traversent les frontières et ne connaissent aucune classe sociale, ethnie ou religion. Par exemple, les policiers disent beaucoup des rapports sociaux, des conflits intimes et collectifs… Il suffit de regarder Maigret ou Columbo pour s’en convaincre. Plus généralement, les romans noirs radiographient nos sociétés et je reste persuadé qu’ils sont des livres d’histoires écrits en avance.
Interview de Marie Deshaires et Catherine Touzet

Qu’est-ce qui vous a séduites en découvrant le roman Surface ?
C. T. : Olivier Norek écrit des polars très immersifs, qui s’encrent dans des univers aussi angoissants que passionnants. Surface nous a happées par son décor singulier – ce village englouti – et par Noémie Chastain, une héroïne atypique, dont le parcours nous a immédiatement intéressées. Il s’agissait d’accentuer le côté « western » d’une femme qui débarque dans une bourgade endormie et tente de réveiller ses secrets.
Noémie vous a-t-elle particulièrement touchées notamment en tant que femme ?
M. D. : C’est un personnage puissant et très humain. On ne peut qu’être touché par son passé, ses failles et sa résilience. Malgré ses traumatismes, c’est une femme indépendante, dotée d’un humour « pince-sans-rire » à l’anglaise – qui fonctionne très bien avec Laura Smet –, mais qui reste capable d’une grande empathie. C’est ce mélange de force et de vulnérabilité que nous avons voulu creuser.
C. T. : Sa cicatrice extérieure n’est pas sa seule blessure. En tant que scénaristes, nous voulions faire remonter ses traumatismes enfouis, qu’elle cherche pourtant à taire.
Le dit et le non-dit, le visible et l’invisible, le passé et le présent…
Le titre Surface renvoie à un univers symbolique et allégorique qui traverse tout le roman. Comment avez-vous traduit cette métaphore à l’écran ?
C. T. : Comment rendre explicite ce qui ne l’était pas ? C’est dans cette problématique que résidait l’un des grands enjeux du projet. L’enquête en elle-même était plutôt simple à traduire en image. Faire remonter des fûts contenant des squelettes, par exemple, n’était pas un défi visuel majeur. La complexité portait davantage sur le passé de Noémie, qu’il s’agissait de raconter à l’écran. Dans le roman, le lecteur entre dans l’inconscient de l’héroïne grâce aux nombreux échanges téléphoniques qu’elle entretient avec son psychologue. Ces conversations font avancer le récit et s’intègrent bien dans un roman, pas dans une série. En collaboration avec Slimane-Baptiste Berhoun, le réalisateur, nous sommes allés du côté du rêve et de la métaphore visuelle pour traiter ses traumatismes. Tout en capitalisant sur l’imaginaire du village englouti, nous avons donc créé cet univers onirique qui se passe sous l’eau, mais surtout dans sa tête.
Vous travaillez souvent sur des séries policières. Qu’est-ce qui fait la singularité de Surface par rapport à vos autres créations ?
M. D. : Avec Surface, nous sommes sorties du cadre classique du polar, habituellement centré autour des faits. En s’émancipant du réalisme, le scénario peut aller explorer des univers plus intimes et psychanalytiques.
Derrière la série Surface, il y a le roman d’Olivier Norek. En tant que scénaristes, devoir travailler à partir du texte d’un autre est-il un frein à la liberté de création ?
M. D. : Au contraire, je crois que l’adaptation est une forme de création, qui dépasse la simple traduction. Nous repensons la trame narrative du roman en l’adaptant au format sériel. Le roman devient ce moteur que l’on démonte pièce par pièce, avant de le restructurer pour le rendre plus performant. Nous lui ajoutons des rebondissements, des moments de tension, des « cliffhangers »… C’est ici que réside notre latitude de création.
Olivier Norek a-t-il exercé son droit de regard sur votre travail ?
C. T. : Dès le départ, nous avions la pleine liberté sur l’adaptation. Il s’agissait simplement de respecter le sens premier de son roman. Du reste, nous étions libres d’inventer, de modifier, d’enlever ou d’ajouter. C’est ainsi que nous avons retravaillé certains personnages. Par exemple, dans le livre, Catherine Valant est un homme et Nadège n’existe pas. Bien sûr, tous ces changements devaient servir le récit et aucun d’entre eux n’était gratuit. Parce que finalement, savoir adapter, c’est pouvoir rester fidèle à l’œuvre originale malgré les réécritures.
Interview Théo Costa-Marini

Qui est Romain Valant, le personnage que vous incarnez à l’écran ?
T. C.-M. : Romain Valant est un lieutenant de police d’Avalone, ville qu’il connaît bien pour y avoir grandi. Porté par l’envie de bien faire, Romain a un sens aiguisé de la justice, du devoir, de la famille et de la communauté. À travers les rapports qu’il entretient avec ses collègues et les habitants du village, il incarne des valeurs d’entraide et de vivre-ensemble, qui sont généralement valorisées en ruralité.
Comment avez-vous abordé ce rôle ?
T. C.-M. : Romain s’est construit au fil des épisodes. L’écriture du personnage ne précisait pas ses contours. Dans ce vide laissé libre à l’interprétation, il s’agissait d’y mettre un peu de sa propre sensibilité. En tant qu’acteur, c’est très stimulant de « jouer en creux », en ayant l’espace suffisant pour pouvoir caractériser son personnage et son évolution.
Romain est impliqué dans une affaire qui le touche personnellement : il est à la fois enquêteur et ami d’enfance des trois disparus. En tant qu’acteur, comment jouer sur ces deux tableaux ?
T. C.-M. : C’est un numéro d’équilibistre qui nécessite de faire des choix. Heureusement, je pouvais m’en remettre à Slimane-Baptiste Berhoun, qui connaissait parfaitement le scénario et nous dirigeait grâce à sa maîtrise des arcs narratifs. Sous sa supervision, j’ai réussi à délimiter mon jeu sans déséquilibrer le personnage. De mon côté, j’ai surtout travaillé la mémoire de Romain en creusant son passé et ses souvenirs, plus ou moins enfouis…
Noémie Chastain semble être un miroir de Romain Valant. Tous deux sont policiers, marqués par un passé qu’ils essaient d’enterrer, et en quête de reconstruction. Peut-on lire Romain à travers Noémie, Noémie à travers Romain ?
T. C.-M. : Les deux se répondent en écho. Romain camoufle ses failles, Noémie les porte sur son visage. Il l’admire pour son courage, elle le comprend dans sa vulnérabilité. Entre eux se tisse une connexion silencieuse, nourrie de leur fragilité commune. Je trouve beaucoup de beauté dans cette relation.
En dehors de votre rôle, quels sont vos personnages préférés ?
T. C.-M. : Évidemment, je me suis attaché à toute l’équipe du commissariat. Selon moi, elle est essentielle à l’intrigue et permet d’équilibrer le récit. J’ai également noué un lien particulier avec Catherine Valant, ma mère dans la série, incarnée par l’immense Florence Muller. Je garde un très beau souvenir de notre rencontre et des scènes que nous avons partagées ensemble.